
Sport et santé mentale sont inextricablement liés : ce n’est pas Emilie Senez, psychologue à la Ligue de Santé Mentale, qui dira le contraire. Décryptage sous son œil expert des interactions entre activité physique et bien-être psychologique.
Mobilisé dans l’accompagnement de personnes en souffrance mentale, le Service Prévention Formation de la Ligue de Santé Mentale (LSM), conventionnée par le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale, est particulièrement actif dans son rôle de promotion de la santé mentale. Ciné-débats, journées d’étude, semaines dédiées ou encore formations au grand public, aux entreprises et aux professionnels sur de nombreuses thématiques liées à la santé mentales, tout est fait pour toucher un public le plus large possible.

Emilie Senez, psychologue à la LSM et coordinatrice prévention du suicide, confie avoir été au cours de sa carrière de clinicienne en contact avec des sportifs en difficulté, « souvent après une blessure ou des échecs, mais aussi parfois pour un bilan auprès de jeunes sportifs soumis à beaucoup de pression. » Cette pression, qu’elle vienne de l’entraîneur, de l’entourage, des sponsors ou qu’on se l’inflige à soi-même, peut avoir selon elle des effets dévastateurs : dépression, insomnies, troubles du comportement alimentaire et surtout anxiété. Or « chez le sportif, il peut être difficile de distinguer ce qui relève de la fatigue ou d’un mal-être psychologique ».
Certains symptômes peuvent cependant être de précieux indicateurs et alerter sur la santé mentale d’un athlète. « Il faut être vigilant face aux changements : un isolement soudain, une irritabilité inhabituelle ou au contraire une forme d’apathie, et la perte de plaisir », précise Emilie Senez. Et un mal-être intérieur chez un joueur ou un athlète va également avoir des conséquences physiques : « troubles du sommeil, fatigue persistante, ces facteurs vont entraîner un risque de blessures à répétition et de terrain propice à la maladie, ce qui crée un cercle vicieux : la souffrance psychique fragilise le corps, et les contre-performances renforcent à leur tour le mal-être… »
Certains signaux émotionnels peuvent aider à repérer une santé mentale défaillante. Lorsqu’un sportif tient un discours systématiquement dévalorisant sur lui-même, qu’il présente une anxiété de performance ou une perte de confiance en lui, il n’est plus à même de se dépasser et peut aller jusqu’à adopter des comportements à risque. Alcool, jeu en ligne, cannabis, et même parfois produits dopants, jusqu’à des idées suicidaires. En témoigne une publication sur les réseaux sociaux de la cycliste néo-zélandaise Olivia Podmore, en forme de lettre d’adieu quelques heures avant de se donner la mort : « Le sentiment lorsque vous gagnez est unique, mais le sentiment lorsque vous perdez, lorsque vous n’êtes pas sélectionné même si vous vous qualifiez, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous ne répondez pas aux attentes de la société parce que vous essayez de tout donner à votre sport, ne ressemble également à aucun autre. »
La première étape est donc d’abord de déceler le mal-être, et il peut être difficile de s’en rendre compte par soi-même. C’est pourquoi la LSM dispense des formations de Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) au Luxembourg, dans l’optique de « développer une culture de la prévention ». Il permet de « former des équipes pédagogiques avec le PSSM Youth mais aussi et surtout le grand public avec le PSSM Standard, dans les entreprises et plus généralement toute personne désireuse de devenir secouriste en santé mentale. La version PSSM Teen s’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans ». Pour Emilie Senez, une fois un mal-être identifié, il s’agit alors « d’ouvrir la porte au dialogue, montrer qu’on est attentif et à l’écoute de l’autre. »
Pas facile dans le monde du sport, celui de la culture de la gagne, de la force, voire d’une certaine virilité où la santé mentale est synonyme de vulnérabilité. « Il faut changer les représentations dans le sport, valoriser les sportifs qui ont osé en parler. C’est aussi l’un des rôles du coach, qui a une influence sur celles et ceux qu’il entraîne. Mais ce n’est pas un psychologue : il doit alors orienter pour trouver le meilleur accompagnement. Cela peut déjà passer par le médecin traitant qui dirigera ensuite vers une prise en charge psychologique. »
Quels pourraient être les leviers pour améliorer la prise en compte de la santé mentale dans le domaine sportif ? L’une des pistes évoquées par la psychologue de la LSM est la création d’espaces de paroles réguliers. « En offrant par exemple au début de chaque entraînement un temps d’échange sur son état intérieur, collectivement ou individuellement. Les fédérations ont également un rôle à jouer, avec des campagnes au sein des clubs, et surtout avec les centres de formation pour que les sportifs les plus jeunes soient sensibilisés. » Cela passera forcément par le dépassement conscient du tabou des apports du travail psychologique dans la performance : les clubs s’entourent volontiers d’analystes vidéos, de préparateurs physiques, de nutritionnistes et autres kinés, mais les bancs de touche et les staffs médicaux sont bien déserts en psychologues, regrette Emilie Senez.
« Pourtant les plus hautes instances ont développé des outils : le Comité International Olympique a par exemple édité le SMHRT-1 », une trame qui permet de repérer des « drapeaux rouges » sur la santé mentale dans le sport et d’orienter. L’UEFA a également développé son module « Mental Health » du programme Take care avec une boîte à outils à destination des fédérations, clubs, staffs et athlètes sur le modèle du « Mental Health tool kit » du CIO. Ces outils entendent dédramatiser l’échec et surtout ne pas résumer le sportif à sa performance : « Le risque principal en cas d’échec est d’associer sa valeur personnelle à ses résultats, et de susciter la déception. Or la confiance en soi est la clé d’une performance durable. »
Mais malgré les prises de parole récurrentes des sportifs et une réelle volonté politique, la santé mentale semble encore stigmatisée dans le sport, alors même que le chemin inverse est désormais acté dans l’inconscient collectif et validé par la communauté scientifique. Emilie Senez rappelle que « les vertus curatives du sport ne sont plus à prouver. Une étude cliniques parue en 2022 dans Jama Psychiatry* a montré que pratiquer la moitié des recommandations de l’OMS, soit 1h15 d’activité physique par semaine, faisait diminuer de 20% les risques de dépression. À partir de 2h30 par semaine, on atteint même les -30% ! Une étude encore plus récente réalisée sur une cohorte de 90.000 personnes* a prouvé qu’à partir de 7.000 pas par jour, le risque de dépression chutait de 30%. L’impact du sport sur la santé mentale est évident : il vaut mieux bouger un peu que pas du tout. »
L’exercice réduit donc le risque mais aussi les symptômes dépressifs. Les effets sont même d’après la psychologue de la Ligue comparables à une action médicamenteuse : « les études scientifiques* ont prouvé une pratique du sport régulière et d’une bonne intensité ont des effets comparables à la prise d’anti dépresseurs », grâce à ses effets biologiques, psychologiques et sociaux. Et en effet, outre la fierté, l’estime de soi et la maîtrise de son corps, l’activité physique est un facilitateur d’intégration sociale : « on sort de l’isolement, on rencontre des gens, cela réduit l’anxiété de manière significative, à condition de respecter les temps de récupération. » Rien d’étonnant donc à ce que la ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale promeuve le sport sur ordonnance.
* Sources :
– « Sport Mental Health Recognition Tool 1 (SMHRT-1): towards better support of athletes’ mental health » Gouttebarge et al (International Olympic Committee, 2021)
– « Association Between Physical Activity and Risk of Depression », M.Pearce PHD, L.Garcia PhD, A.Abbas PhD, et al (in Jama Psychiatry vol.79, n°6, 2022).
– « Daily Step Count and Depression in Adults », B.Bizzozero-Peroni PhD & MPH, V.Díaz-Goñi MPH, E.Jiménez-López PhD & MPH, et al (in Jama Network Open vol.7, n°12, 2024).
– « Comparative effectiveness of exercise, antidepressants and their combination in treating non-severe depression », F.Recchia, C.K.Leung, E.C.Chin, et al (in BMJ Journals, vol.57, n°23, 2022)
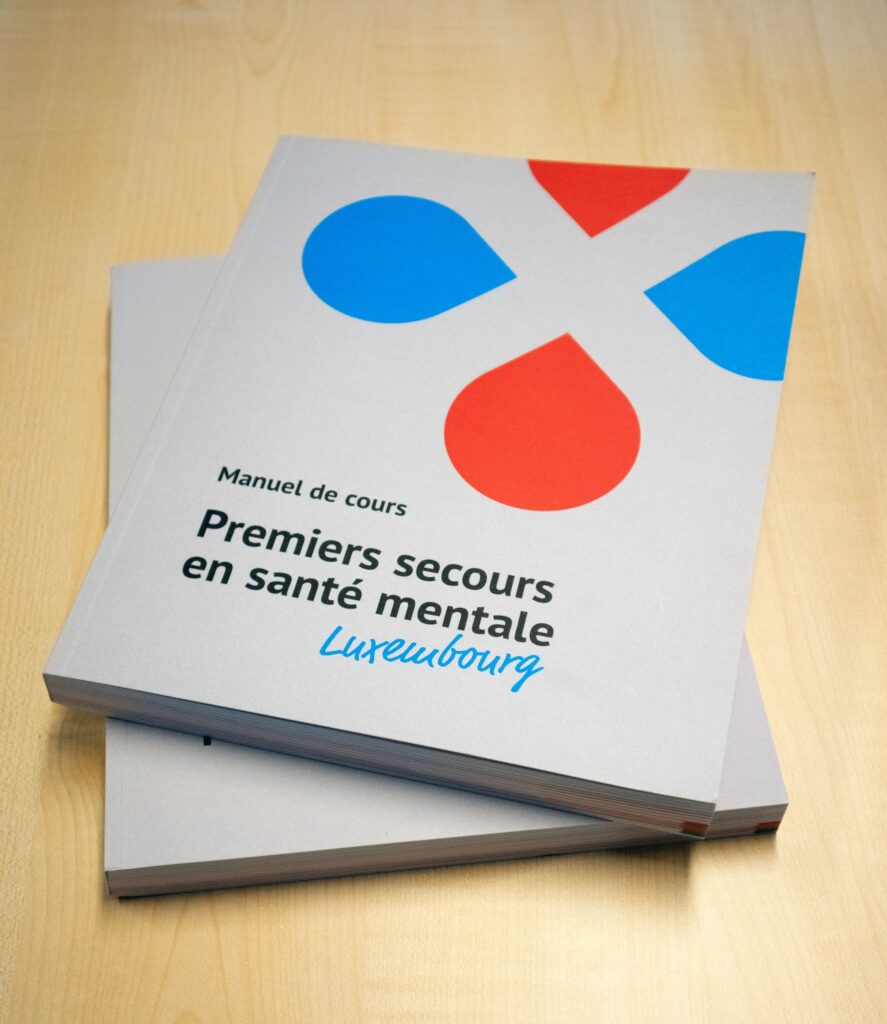
Mental Médias SARL
15 Rue Emile Mark
L-4620 Differdange LUXEMBOURG